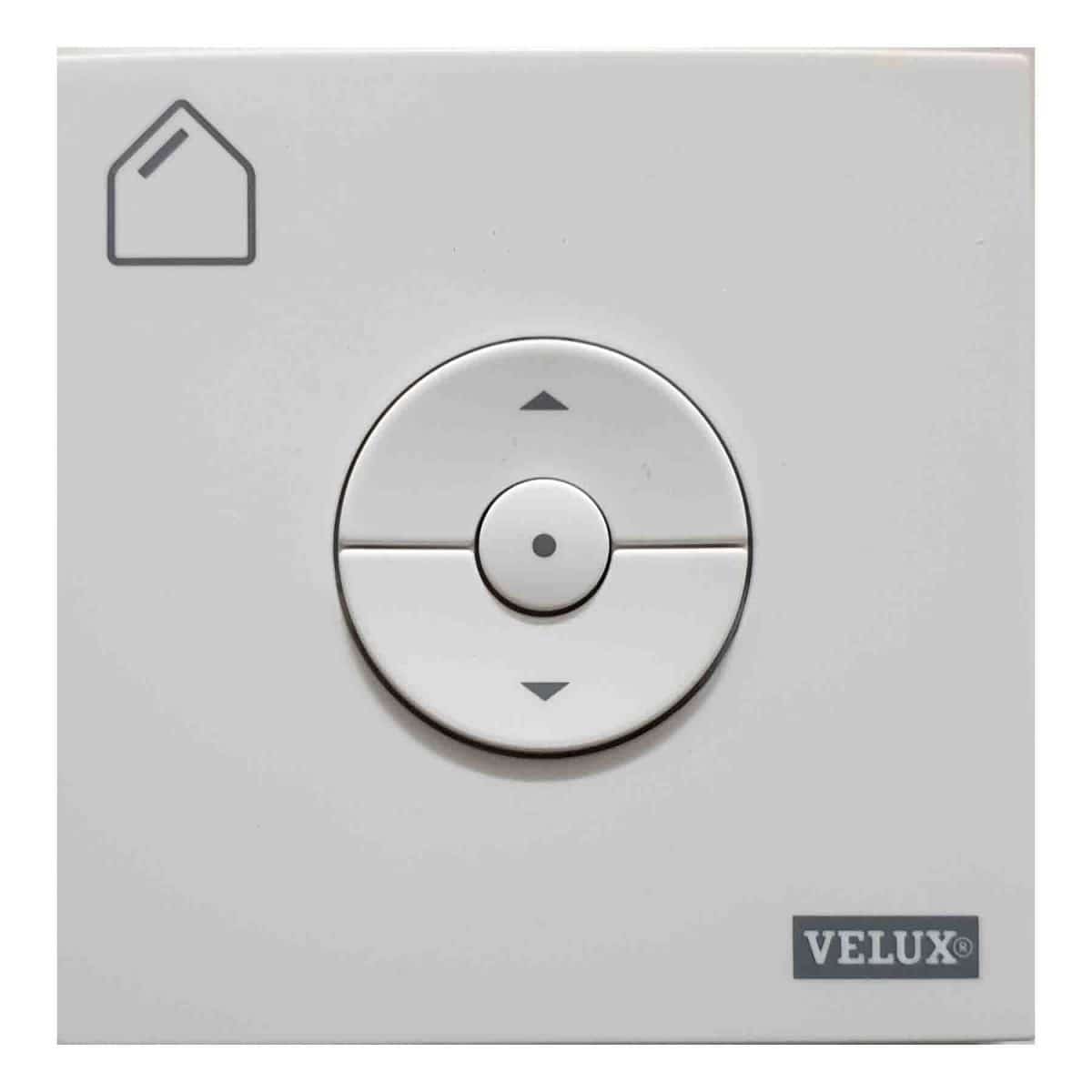La langue française, dans sa forme officielle, ignore le neutre. Pourtant, chaque année, le nombre de personnes qui ne se rangent ni du côté du masculin ni du féminin continue de grimper. Face à ce mouvement, le besoin d’un langage plus inclusif s’impose. Mais dans la vie courante, le manque d’accord entre pronoms et formulations fait naître des hésitations, des maladresses, parfois même des tensions.
Voici comment les institutions se partagent entre ouverture aux néopronoms et maintien des usages classiques. Ce sont des ajustements précis, dans les mots choisis, les accords, mais aussi dans l’attitude, qui dessinent aujourd’hui les nouvelles règles du respect.
Comprendre ce que signifie être non binaire
Une personne non-binaire ne se reconnaît pas totalement dans la catégorie du genre masculin ni dans celle du genre féminin. Son identité se construit en dehors des cases binaires qui dominent la société et, de fait, la langue. Pendant longtemps, le genre binaire s’imposait sans discussion. Il devient aujourd’hui évident qu’il n’explique pas toute la diversité vécue.
La non-binarité regroupe toutes les formes d’identités de genre qui dépassent l’opposition homme/femme. Les trajectoires sont variées et on retrouve notamment plusieurs identités :
- genderfluid
- agenre
- demi-genre
Une personne non-binaire peut choisir d’exprimer son genre de façon différente de ce que laisse penser son apparence, changer de prénom, utiliser de nouveaux pronoms, ou adopter un style vestimentaire distinct. La transition de genre peut prendre plusieurs formes : démarches sociales, administratives, parfois médicales.
Des artistes comme Sam Smith, Demi Lovato, Sara Ramirez ou Lachlan Watson ont permis au grand public de découvrir d’autres réalités. Pourtant, la non-binarité existe depuis bien plus longtemps et se retrouve dans de nombreuses cultures, loin des clichés d’effet de mode.
Le coming out représente souvent un défi au quotidien : réactions mitigées, refus de comprendre, mégenrage. Les termes « cisgenre » et « transgenre » ne suffisent pas à refléter toute cette complexité. Ce qui compte vraiment : entendre ce que la personne exprime, respecter ses mots, ses pronoms, le prénom qu’elle choisit. C’est toujours par là que tout commence.
Pourquoi le langage inclusif est essentiel pour le respect de chacun
La langue française influence la manière de voir les autres. Employer une écriture inclusive n’est pas un effet de mode, mais la reconnaissance de vécus longtemps ignorés. Les personnes non-binaires demandent simplement que leur identité de genre existe, aussi, dans le langage. Choix de pronom, accords, civilités : ces détails bouleversent le rapport au mégenrage, cette violence qui gomment les différences et nie l’existence d’une personne.
Le pronom « iel » est désormais mentionné dans Le Petit Robert. Il ne s’agit pas d’un engouement superficiel : ce mot vient répondre à une réalité quotidienne. D’autres moyens comme les accords dégenrés ou le point médian, déjà utilisés par de nombreux médias, permettent d’employer la langue sans imposer une norme figée.
Pour mieux saisir les enjeux, voici quelques pistes concrètes :
- Le mégenrage laisse des traces : utiliser un pronom ou accorder d’une façon contraire à la volonté de la personne revient à nier son identité.
- Privilégier une civilité neutre (par exemple : « Mx », « monêtre ») propose à chacun·e d’être accueilli·e sans jugement, y compris dans les services publics ou les grandes entreprises.
Les accords dégenrés n’abîment pas la langue : au contraire, ils lui ouvrent l’espace permettant de nommer tous ceux et toutes celles qui n’y avaient pas leur place. S’opposer à la transphobie et à l’enbyphobie commence par le choix des mots, dans les interactions ordinaires, dans les emails, dans une simple présentation. C’est une attention décisive, là, tout de suite.
Comment choisir les bons pronoms et accords avec une personne non binaire ?
Se renseigner sur les pronoms préférés n’est pas une formalité : c’est le point de départ pour respecter quelqu’un dans toute sa singularité. Lorsqu’on s’adresse à une personne non-binaire, il suffit de demander : « Quels pronoms veux-tu qu’on utilise ? » « Iel », « elle », « il », « ellui », « ol »… Les déclinaisons existent, chacune reflétant une histoire et une volonté unique. On rencontre également des néo-pronoms moins répandus, parfois choisis selon le moment, l’environnement ou l’évolution du parcours d’une personne.
Pour les adjectifs ou les participes, même approche : on privilégie des formulations neutres, des termes épicènes si c’est possible, ou l’écriture inclusive (comme « ami·e », « heureux·se »). Quand un doute se pose, le demander directement reste la manière la plus respectueuse : ce simple réflexe protège de l’écueil du mégenrage et affirme la reconnaissance de l’identité de genre.
Pour éviter les faux-pas et rendre les échanges plus naturels, retenez ces gestes simples :
- Interrogez franchement : « Quels pronoms utilises-tu ?» avant d’aller plus loin.
- Respectez ces choix sans improviser et sans raccourci.
- Simplifiez les phrases avec des adjectifs ou des termes épicènes dès que c’est possible, ou reformulez pour ne pas imposer un genre.
La langue s’adapte : néopronoms, civilité neutre, point médian, usage du pluriel non genré… Tout cela se construit, chaque jour, dans les conversations. Rien ne vaut la constance : ce sont les petits changements qui, à terme, modifient l’atmosphère des échanges.
Conseils concrets pour soutenir un·e ami·e non binaire au quotidien
Être un vrai soutien pour un·e ami non binaire, c’est porter une attention sincère aux détails qui envoient un message fort. Employer le prénom choisi, respecter les pronoms préférés : ces gestes banals deviennent porteurs de reconnaissance. Avant de parler, mieux vaut questionner plutôt qu’imaginer ou trancher selon l’apparence. Nombre de personnes non-binaires témoignent que chaque histoire, chaque manière de vivre son genre, est personnelle et changeante.
L’appui concerne aussi la vie sociale : recadrer calmement un mégenrage dont on est témoin, expliquer autour de soi pourquoi le langage inclusif compte, utiliser à l’oral ou à l’écrit des civilités neutres comme « Mx » ou, pour parler des proches, préférer des termes comme « frœur », « parent », « cousan ». Ces alternatives desserrent l’étau des appellations masculines ou féminines.
Pour faciliter le quotidien et apporter un vrai soutien, il existe plusieurs solutions concrètes et sources d’information :
- Se rapprocher de groupes de parole, consulter des guides pratiques ou des plateformes d’écoute qui expliquent les démarches et les besoins spécifiques des personnes non-binaires et de leurs proches.
- Prendre l’initiative de relayer les dates clés, les actions de visibilité collective, ou de faire passer des messages de soutien dans le cercle amical comme au travail.
- Parler ouvertement de ces sujets pour aider chacun·e à trouver le vocabulaire qui lui correspond, et ouvrir la discussion dans l’entourage.
Mettre ces conseils en œuvre, c’est créer de l’espace pour que chacune et chacun puisse exister sans appréhension, et permettre, geste après geste, que le respect devienne la norme. La langue ne reste jamais figée : ceux qui choisissent l’écoute, au fil des jours, refondent une société plus vaste, moins étroite et résolument plus accueillante.